
En prenant conscience de tous les enjeux liés à l'état d’écoute active, il faut envisager la dimension créatrice et artistique de cet espace d’expression théâtrale. Le match d’improvisation doit son originalité aux multiples valeurs connexes qu’il implique, et qui permet des approches très différentes. Toutefois, le cœur de tout cela, c’est cette patinoire vide qui appelle l’esprit à s’émanciper et à se surpasser pour produire ce que le joueur ne soupçonnait pas être capable de créer.
Pour introduire ce chapitre, nous vous proposons une citation d’Alain Knapp, professeur de théâtre réputé:
“La création est un jeu entre la vérité et le mensonge; pour que le moi puisse jouer avec lui-même, il faut qu’il se dégage de ce qu’il l’englue, non pas en remontant aux sources de ses refoulements, comme une psychanalyse, mais en les utilisant, en rusant avec eux pour les projeter dans une forme. La création échappe à tout système. Elle n’est authentique que dans l’inattendu.”[1]
Sachant ce qui se joue dans le match, aussi bien par l’étude des règles que par celle de tous les mécanismes qui entrent en jeu, nous pouvons prendre conscience de la fiabilité du cadre dans lequel l’esprit créatif va pouvoir s’épanouir. Si nous considérons le match comme un fabuleux espace de création, et que d’aucuns trouveraient rigide, c’est qu’il définit les cadres indispensables qui agissent comme autant de conventions pour que l’espace vide puisse se remplir de ce moment de théâtre dont la valeur essentielle naît du fait qu’il est inattendu et éphémère. Ainsi le jeu pourra se libérer des cadres, qui ne sont qu’une forme. La création pourra prendre toute sa dimension, car les règles et les codes ne lui imposent rien sur le fond, et laissent ouverts tous les champs des possibles. Faut-il encore que les cadres soient clairs et que les arbitres ne sortent pas de leur rôle.
Mais les mécanismes créatifs ne produisent rien. Seul le comédien est moteur de sa propre création, et l’histoire qu’il va écrire peut prendre toutes les formes, en fonction de l’utilisation qu’il va faire de ces mécanismes. Pour utiliser la métaphore, nous pouvons dire que le joueur est le jardinier de sa création, et qu’il va devoir faire germer la graine avec laquelle il entre en jeu. Graine que lui aura fournie son coach ou qu’il aura produite lui-même.
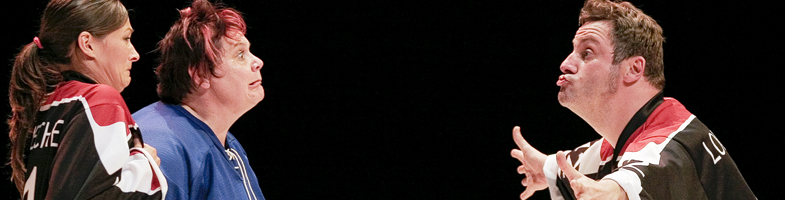
La graine de notre jardinier, ou l’objet activant (terme emprunté à Alain Knapp) de notre joueur constitue le ferment de son action. Objet qu’il devra transformer en objet dramatique. En entrant dans la patinoire notre comédien est chargé de matière, suscité par le thème, ou simplement par son imagination. Ce que nous appelons matière peut revêtir plusieurs formes. Ce peut être aussi bien un état, qu’un objectif, qu’un lieu, qu’une mission, qu’un personnage... Tout peut être matière de création. Au même titre que le sculpteur pourra sculpter dans le marbre ou en assemblant des boîtes de conserves. Cette matière que nous appelons objet activant, devient donc la graine insignifiante de laquelle va naître l’arbre signifiant. Cette graine est insignifiante car elle n’a aucune valeur autre qu’utilitaire. Cette graine ne nous intéresse pas en tant que graine mais en tant qu’objet appartenant à un personnage qui va en faire quelque chose. Ce qui nous intéresse, c’est le sens que peut avoir l’objet dans la vie du personnage. Que symbolise cette tristesse, cette lettre, ce jardin public, cet accent... Ainsi Alain Knapp explique:
“La finalité utilitaire de l’action importe peu, son intérêt tient dans ce qu’elle nous permet d’apprendre du personnage agissant”[2].
Maintenant, toute la démarche du comédien créateur consiste à donner à cet objet une valeur significative pour en faire un moteur dramaturgique, sans tomber dans le piège de la justification qui étoufferait toute chance d’évolution. En effet, justifier l’objet est une démarche explicative et non active. Ma présence ne doit pas se justifier par telle ou telle raison, mais doit s’imposer par l’impérieuse nécessité de mon personnage, démarche active en soi, a résoudre le problème qui le préoccupe. Bien sûr, le comédien doit donner à voir et à comprendre. Il doit donner du sens à son action pour qu’elle trouve écho auprès du public et des autres joueurs. Mais il doit donner du sens dans l’action.
Avant d’aller plus loin, il convient de s’entendre sur les termes. “L’action” ne se résume pas à une multitude d’actes plus ou moins rapides qui doivent donner l’illusion que l’histoire avance. Par “action” nous entendons l’ensemble des actes qui sont vécus, et donc investis par le personnage. Ainsi, un personnage peut être actif en étant simplement imprégné d’une émotion forte. Parler est une action quand cela ne se résume pas à une diatribe explicatoire. Cette précision doit chasser l’idée reçue qui convient à dire que l’improvisation ne peut être réussie sans un surcroît d’actes, de changements de lieux, d’entrées et sorties multiples, etc... Si “l’impro n’avance pas”, pour reprendre des termes souvent entendus sur les bancs, c’est souvent le signe que les comédiens se perdent dans des actes qui ne sont pas investis et qu’ils se sentent obligés de continuellement justifier.
Cela nous amène aussi à l’idée qu’il n’y a pas de petit ou de grand objet activant. Il n’y a pas d’objet plus riche que d’autre. On peut convenir toutefois que tel objet sera plus inspirant pour un comédien que pour un autre, car la symbolique liée à cet objet correspondra mieux au mode de création de tel ou tel. Mais ce n’est pas l’objet qui fait l’improvisation. De même, l’idée qui émane du caucus n’a pas à être grandiose pour que l’improvisation soit géniale.
Nous l’avons vu en évoquant les mécanismes d’interaction, l’action commune naîtra de la fusion des deux propositions. Ce qui veut dire que l’objet activant de chacun ne peut avoir de finalité en soi, car la finalité de l’histoire est inconnue et qu’elle le restera tant que les deux actions n’auront pas fusionné dans un but commun.
La peur du vide, la pression du temps, l’angoisse de l’inconnu... Tout cela nous pousse inévitablement à vouloir prévoir, à anticiper, pour rassurer notre esprit créatif qui n’est pourtant guidé que par notre inconscient. Nous devons pourtant nous défaire de cette “pensée analytique”, telle que l’appelle Knapp, pour aller vers une “pensée créatrice” qui utilise les éléments dont elle dispose pour élaborer des conséquences dynamiques.

Une des données importantes donnée dans le thème par l’arbitre est la durée de l’improvisation. De trente secondes à vingt minutes, voilà le temps qui est imparti aux joueurs pour improviser. Vingt minutes, cela peut paraître très long, mais au vu de l’écriture théâtrale, cela est très court: un acte, quelques scènes... Et la plupart des improvisations fait moins de dix minutes. Il est donc fondamental de ne jamais oublier une base essentielle de l’écriture improvisée, c’est que nous n’écrivons que des tranches de vie, et que si nous avons la prétention d’écrire des histoires, ce ne seront que des histoires courtes, ou des bouts d’histoires. Nous sommes pour le théâtre, ce que le court métrage est au cinéma. Cela n’est pas une constatation réductrice mais un élément constitutif du format de nos histoires. Nous écrivons avant tout des tranches de vie.
Cette notion est souvent oubliée, car de fait, l’improvisation se crée au présent et ne connaît ni son passé, ni son avenir. L’écriture part donc souvent de zéro, du commencement, de la genèse. Ainsi les personnages passent du temps à faire connaissance, on se perd dans des prologues qui au final nous font perdre du temps, ou tout du moins n’apportent rien d’autre que fioritures et préambules dont l’histoire peut se passer.
Écrire des histoires courtes, cela ne doit pas pour autant nous contraindre à la précipitation, mais sans doute plus à la simplification: simplification des coachings, simplification des objectifs, simplification des problématiques. Nous n’écrirons pas en cinq minutes, ce que les plus grands auteurs développent en plusieurs actes. Il faut avoir conscience de la simplicité de cet art, car c’est en cela que réside sa plus grande force.
L’écriture improvisée doit s’anticiper elle-même. Ce qui s’écrit au présent doit être chargé d’un passé qui s’écrit en même temps. Lorsque le joueur incarne un personnage, il doit l’incarner dans le moment qui se joue, tout en justifiant ses actes par le passé de ce personnage, passé qui s’écrit en même temps. Et en allant plus loin, on peut même dire que l’acte présent se justifie aussi par la volonté future. Cette capacité du joueur à enrichir ainsi l’action présente par un passé et un avenir donnera toute l’épaisseur historique au personnage qui deviendra alors beaucoup plus riche et plus fort. Cela implique une ouverture du joueur et une adaptabilité à tous les évènements qui surgissent. On joue avec les évidences. Je sais pourquoi je suis là, je sais qui est l’autre, et je prends en compte tous les évènements, pas seulement par rapport à la situation présente mais également par rapport à mon histoire.
Cette épaisseur historique donnée à l’improvisation permettra aux joueurs de se passer de préambule. Combien d’improvisations commencent par un incontournable “bonjour!” qui est le plus souvent le signe avant-coureur d’une approche longue et difficile entre les personnages. Tout ce qui n’est pas évident doit être expliqué. Alors, “Evidemment on se connaît”, ou “évidemment je vous attendais”, “Evidemment vous allez m’aider, car évidemment vous êtes là pour ça”, même si au demeurant, en tant que joueur je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous faites, mais je pars du principe, ou de l’évidence que ce que vous êtes venu faire là correspond exactement à ce que j’attendais de vous. Comme le dit Knapp, il faut transformer les hypothèses en affirmations.
Cela requiert bien sûr pour le joueur une faculté d’adaptation très grande, car les idées les plus antagonistes peuvent être mises face à face. Pourtant quand un moine rencontre un extra-terrestre, il faut qu’il construise avec. Cette difficulté d’adaptation que l’on se doit de surmonter va obligatoirement nous emmener, pour peu qu’on accepte l’autre, dans un imaginaire insoupçonné, et c’est de cela que l’écriture va s’enrichir. Si notre moine rencontre un autre moine, il y a fort à parier qu’ils se raconteront des histoires de moines. Personne ne sera surpris, ni les joueurs, ni les spectateurs. Les joueurs débutants se demandent souvent comment aller de l’avant si l’un des deux protagonistes ne lâche pas son coaching. C’est l’ouverture, l’adaptabilité, l’écoute du joueur qui lui permettra de prendre ce que l’autre lui apporte pour enrichir son histoire, et du coup enrichir l’autre qui est dans la même démarche.
Le coaching, pour le joueur, c’est une image fixe, une photo. A lui de s’imaginer ce qu’il y avait avant la pose, et après la pose. L’improvisation se construira à partir du photomontage des deux images. Avec deux images, on va en créer une troisième pour laquelle il faudra imaginer un avant et un après. Montage sans doute surréaliste mais riche, car tout ce qui sort de notre quotidien nous oblige à nous poser des questions et à mettre en action notre sens critique et notre imaginaire.

L’écriture improvisée a ceci de fabuleux, qu’elle est totalement libre et que le champ des possibles est infini. Elle répond toutefois à des règles, certes vastes car elles proviennent de toute l’histoire du théâtre, mais néanmoins rigoureuses car elles permettent de voir et de comprendre. Nous reprenons le terme d’écriture dramaturgique dans son sens littéral, c’est à dire “l’art de la composition des pièces de théâtre”, selon le Littré. En improvisation, on parle de construction, terme globalisant qui tient compte de tous les paramètres spécifiques au match. Lorsqu’on parle d’écriture, on se focalise sur le déroulé de l’histoire au travers de l’action et de son sens, car c’est bien du théâtre que nous faisons.
Nos histoires, nos tranches de vie vont donc s’écrire en direct, devant les spectateurs avec toutes les contraintes et les pressions temporelles que nous connaissons déjà. Toutefois les joueurs ont souvent bien du mal à comprendre ce qui fait qu’une improvisation est bonne ou non. Comment “construire” une histoire? Comment ne pas tourner en rond? Une des réponses instinctives souvent criée du banc réside dans le mot “action”. Il est étonnant de constater que ce cri du coeur, qui survient quand l’histoire n’avance pas, concentre à lui seul toute l’histoire du théâtre.
Rappelons ici que le mot “action” se dit en grec Drama. Le dramaturge serait donc celui qui écrit des drames, des actions. Le mot drame est porteur aujourd’hui d’un autre sens, mais lorsqu’on parle de drame au théâtre on entend autant “action” que “accident”, que “conflit”. Car l’action prend sens et forme quand elle est générée par des conflits, des problématiques, des accidents. La situation conflictuelle ou problématique pousse les personnages à agir pour survivre, pour résoudre, pour s’extirper d’une situation douloureuse, inconfortable, dérangeante... Les personnages sont en situation de crise, dans la mesure où ils doivent affronter des évènements étrangers à leur quotidien. Ils sont projetés dans une situation inconnue qu’ils doivent gérer et sont exclus du cadre rassurant de la quotidienneté qui n’intéresse le théâtre que quand elle devient le terrain du drame. Le conflit, le problème engendre l’action, et donne du coup un sens et une raison à sa théâtralisation.
L’histoire du théâtre nous donne de multiples conceptions du drame. Les conflits peuvent être externes, entre plusieurs personnes comme chez Molière, ou internes, avec des personnages emprunts à un déchirement intérieur, comme dans Shakespeare. Le conflit peut survenir dans l’action ou être antérieur à cette action. Il peut être généré par les personnages ou par les conditions extérieures, comme chez Brecht. Il peut se résoudre ou non, ou ouvrir des perspectives heureuses ou malheureuses laissant le spectateur arbitre d’une suite possible. Autant de formes d’écritures, de registres qui donnent l’ampleur des possibles en improvisation.
L’improvisateur, de par les contraintes qui lui sont imposées, ne pourra sans doute pas approfondir des drames complexes mettant en jeu de multiples personnages. Mais il se doit, à son niveau, d’utiliser l’action comme moteur pour résoudre les conflits, ou la problématique qu’il aura choisie de développer. Le tout est de ne pas confondre les choses. L’histoire se construit autour du drame et non autour de l’action. Le joueur n’agit pas pour agir, mais pour résoudre un problème. Quand l’histoire stagne et que l’arbitre siffle des retards de jeu, c’est que le conflit n’est pas assez fort pour focaliser tout le monde dans la même action. La solution n’est pas de se perdre dans une course effrénée de tergiversations et autres actes stériles. La solution est dans le conflit et la volonté de le résoudre.
Chaque personnage de l’improvisation doit être porteur d’une problématique, d’un problème à résoudre, d’un conflit à gérer. La difficulté particulière ici, sera dans la confrontation de deux problématiques. Les protagonistes devront donc encore une fois mixer les données de leurs histoires, et faire de leurs deux problématiques une troisième qui les unira dans la même action. Tant que deux problématiques distinctes persistent, il n’y a pas d’écriture possible. Pour cela, chaque personnage devra s’approprier les problèmes de l’autre: “Tes problèmes sont mes problèmes, et ils me concernent”. Les joueurs devront trouver une interdépendance entre leurs problèmes ou leurs conflits, ce qui fera qu’ils deviendront eux-mêmes interdépendants dans l’action. Là encore, la solution n’est pas de céder une problématique pour l’autre, car le joueur sans problème deviendrait immédiatement le serviteur, le suiveur, voire le simple témoin de l’action de l’autre joueur dans la résolution de son problème. Situation peu dynamique.
Au cours de l’improvisation, le drame évolue, la problématique peut changer de forme, les conflits peuvent se résoudre. Et il n’est pas rare que cela se produise avant le coup de sifflet final. Il faut donc créer un nouveau problème, un nouvel accident - terme cher à la commedia dell’arte - , car sans problème, il n’y a pas d’histoire. Ce nouveau problème peut être généré par un nouveau personnage, une nouvelle situation, mais ce ne peut être l’ancien problème qui resurgit, comme ça se produit souvent, car les solutions sont déjà connues de tous, et cela ne donnerait qu’une redondance.
En matière d’écriture, l’improvisation théâtrale jouit d’une certaine liberté et peut se jouer des conventions, dans la mesure où il est clair que nous ne jouons que des tranches de vie, et que par conséquent, nous ne serons pas blâmés de laisser les conflits en plan. Cela en fait un espace d’expression où bien des choses sont permises dans la mesure où elles ont un sens et qu’elles génèrent de l’action, du jeu. Et de fait, tous les modes d’écritures sont permis: du réalisme à l’absurde en passant par le tragique ou le poétique, l’improvisation ne répond à aucun cadre stylistique, même si on peut lui reprocher parfois de se cantonner dans des formes d’humour un peu racoleuses. Les limites sont celles que les joueurs s’imposent plus ou moins consciemment. Les limites imposées par le jeu ne sont que des limites de temps, qui influencent la forme mais pas le fond. C’est pour cela que nous croyons fortement à l’évolution du jeu au travers des différentes formes d’écriture qu’il peut recouvrir, et non dans la transfiguration des règles, tentation malheureusement répandue qui fait oublier l’enjeu principal. Lorsque le jeu semble s’essouffler, ce n’est pas que les règles sont obsolètes, périmées, démodées ou qu’elles ont atteint leurs limites, c’est que les joueurs perdent leur esprit créateur. On aura beau inventer mille catégories ou détourner les cadres, rien ne remplacera la volonté du joueur de se surpasser. On fera au mieux illusion au travers d’un jeu, certes divertissant, mais de moins en moins théâtral. Car si les cadres sont rigides, les possibles du jeu sont infinis. À chacun de réinventer le match d’improvisation théâtrale à chaque fois qu’il entre dans la patinoire.